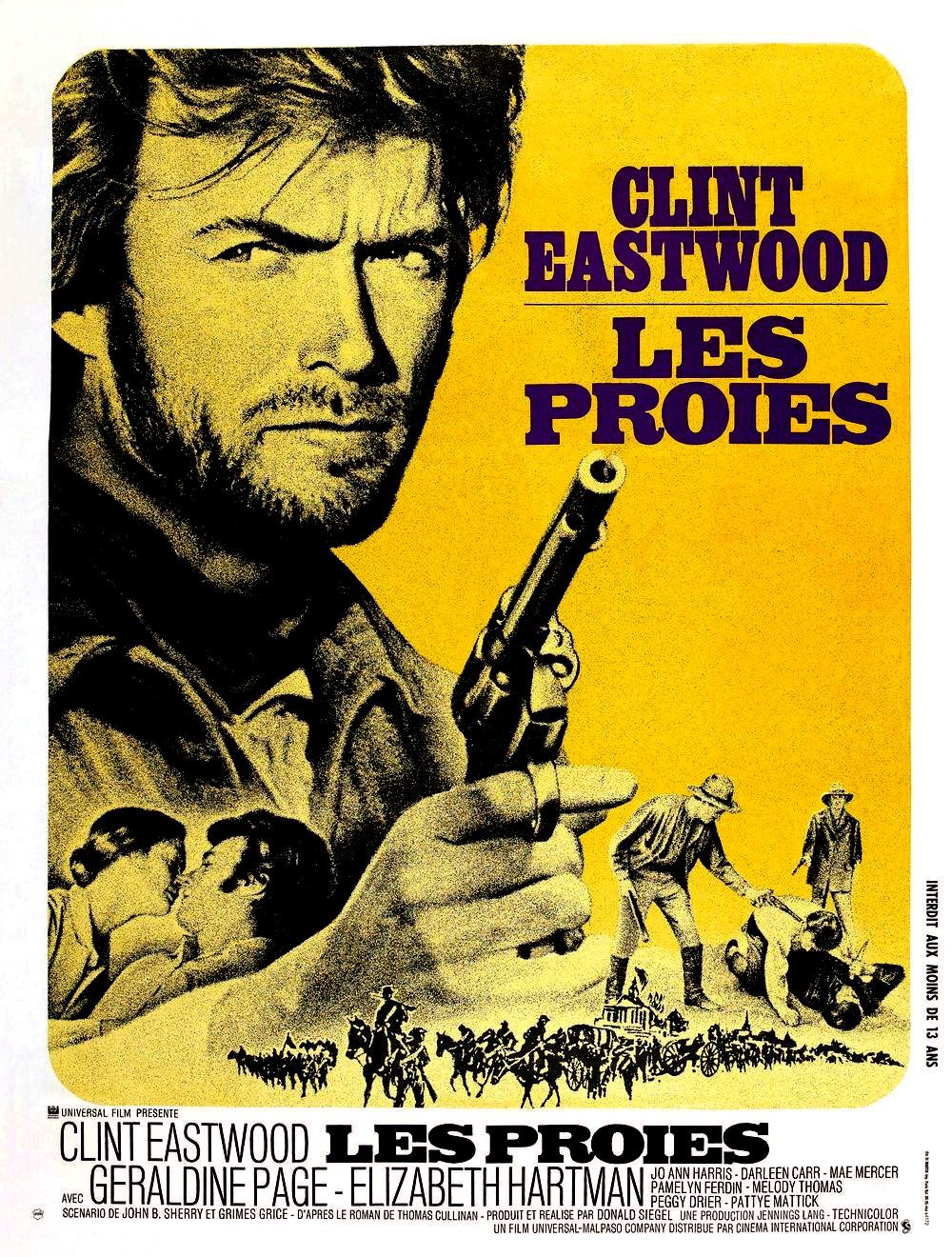Mamma Mia – Here we go again ! (2018)
Comedie Musicale
Un film de Ol Parker
Avec Amanda Seyfried, Lily James, etc
Sortie le 25 Juillet 2018
Distribué par Universal France
Il y a tout juste dix ans, un film naïf et frais débarquait sur nos écrans de cinéma. Cette adaptation d’un succès de la scène anglo-saxonne relevait de l’improbable. Qui aurait pu imaginer Pierce Brosnan, Colin Firth ou Meryl Streep chanter et danser sur les meilleurs tubes du groupe ABBA ? Et pourtant, la recette fonctionnait. Peut-être grâce au plaisir communicatif du casting ou à la fibre nostalgique qu’instaure immédiatement un titre du groupe suédois. Toujours est-il que le film est devenu culte et qu’il remplit encore les salles dix ans après pour des séances karaoké.
On croyait avoir échappé à une suite inutile. On pensait qu’Universal garderait sa pépite telle qu’elle était, mais non ! Il a fallu qu’ils mettent un deuxième film en chantier. Un deuxième film auquel personne ne croyait, Amanda Seyfried en tête comme elle l’a déclaré dans une interview. Les fans tremblaient et ils avaient raison.
Rien n’était fait pour nous rassurer : le retour de Meryl Streep trop longtemps incertain, les chansons qui seraient utilisées puisqu’ils avaient usé tous les grands tubes, l’histoire qui nous serait contée, etc… Dès lors, on ne peut pas dire que ce film soit une déception tant le désastre était annoncé. Au moins, il est cohérent avec ce qu’on en attendait : rien. Enfin, nous espérions tout de même d’avoir tort. Ô doux espoir !
L’histoire est tellement simple qu’en vous racontant le début du film, on vous en raconte aussi la fin. Sophie (Amanda Seyfried) organise la réouverture de l’hôtel de Donna (Meryl Streep) après son décès. En parallèle, nous suivons la jeunesse de Donna (Lily James) qui va rencontrer trois hommes à la suite. On en connaît la fin. Et c’est d’ailleurs le premier défaut scénaristique du film : il n’y a jamais d’enjeu. À ne jamais vouloir choisir entre le préquel ou le sequel, Ol Parker n’en traite aucun des deux.
Dans son intrigue du passé, il accumule les révélations qu’on connaît déjà. On nous raconte une histoire qu’on avait très bien saisie dans le premier. Rien de plus ! Rien de plus, mais tout de même des choses en moins. Ainsi, il charcute le travail de Catherine Johnson, scénariste du premier film et auteur de la comédie musicale. Il réduit les personnages à des caricatures. Donna, dont la jeunesse était dépeinte comme celle d’une femme forte, indépendante et à la sexualité libérée devient esclave de son cœur et prude. Elle semble s’excuser de coucher avec Bill, Sam ou Harry. C’est un contre-sens. Et il fait la même chose sur les autres personnages.
La distribution d’origine s’en rend d’ailleurs compte et tourne en mode automatique. Seule Julie Walters trouve une occasion de faire le clown. Mais ramer sur un paquebot ne sert à rien. Pour ce qui sont des autres, ils sont fantomatiques. Ils déroulent leurs textes et leurs chansons sans énergie. Ce sentiment culmine dans une reprise de Dancing Queen qui référence la même séquence dans le premier opus. Un plan sur le regard de Christine Baransky dévoile qu’elle se demande ce qu’elle fait là. Puis, elle repense aux zéros sur le chèque, et ça va mieux. Le sentiment du spectateur est le même, tout ceci a un goût de réchauffé dans un micro-onde qui marche mal.
Prenons aussi quelques instants pour vous parler de l’usage abusif de la publicité mensongère autour du film. En effet, cela ne vaut pas le coup de parler des jeunes comédiens qui assurent la partie préquel tant ils sont anecdotiques, transparents et choisis uniquement pour leurs beaux minois. Le public attend la grosse annonce, l’élément incontournable de cette suite : la participation de la déesse Cher. Tâchez d’en profiter, elle n’est là que dix minutes. C’en est d’ailleurs dommage tant elle éclaire l’écran et offre une interprétation inoubliable de Fernando avec un Andy Garcia transi. Ne parlons pas de Meryl Streep, au centre sur l’affiche qui ne dépasse pas les 5 minutes de présence à l’écran (sauf si on compte toutes les photos d’elle). À ce compte-là, Marvel devrait penser à mettre Stan Lee sur ses affiches.
Reste le plaisir intact d’entendre les titres d’ABBA qui apporte un vent frais bienvenu en cet été caniculaire. Ils sont particulièrement bien arrangés par Benny Anderson et Bjon Ulvaeus mais servis par une mise en scène à la ramasse. Ce qui n’est pas étonnant quand on sait que le réalisateur lui-même avoue ne pas s’y connaître en comédie-musicale et avoir demandé des conseils à sa fille de 22 ans. Il nous semble que ça résume bien le sérieux de l’entreprise.
Mamma Mia – Here we go again ! est une déception de chaque instant et n’est sauvé de la poubelle que par sa bande originale enthousiasmante qui vous fera bouger sur votre siège. Dommage qu’il soit réalisé comme un mauvais épisode de Glee et, visiblement, sans amour pour le film d’origine. On prend plaisir à retrouver les personnages qu’on a aimé mais on les voit fatigués et lassés. Comment pourrait-il en être autrement devant autant de vide ?